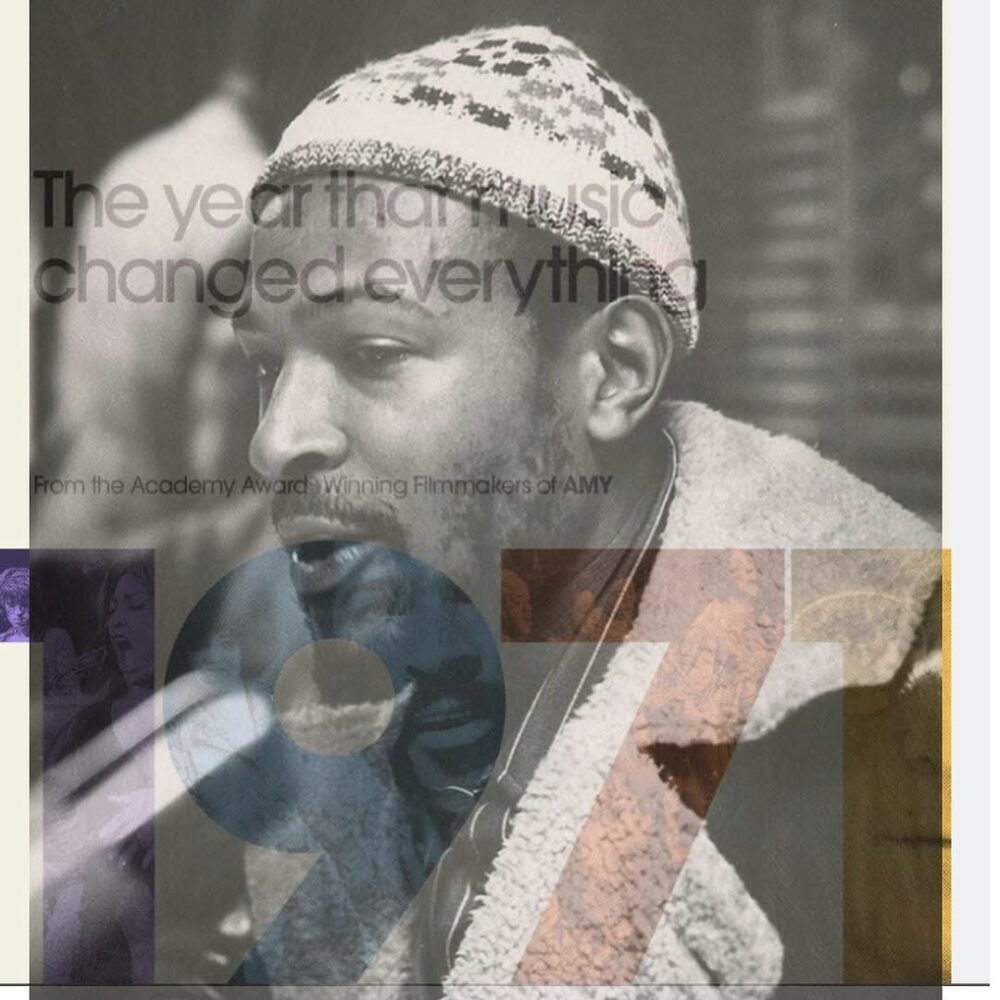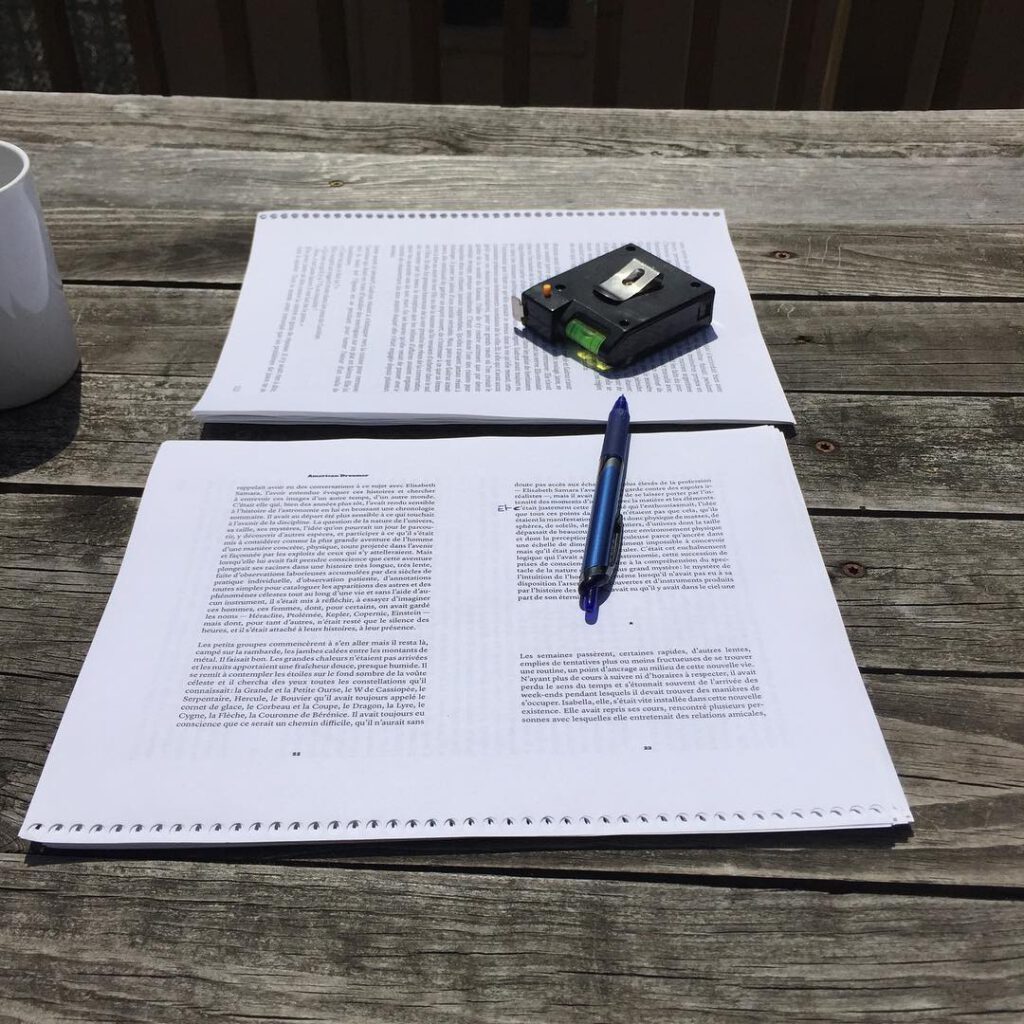
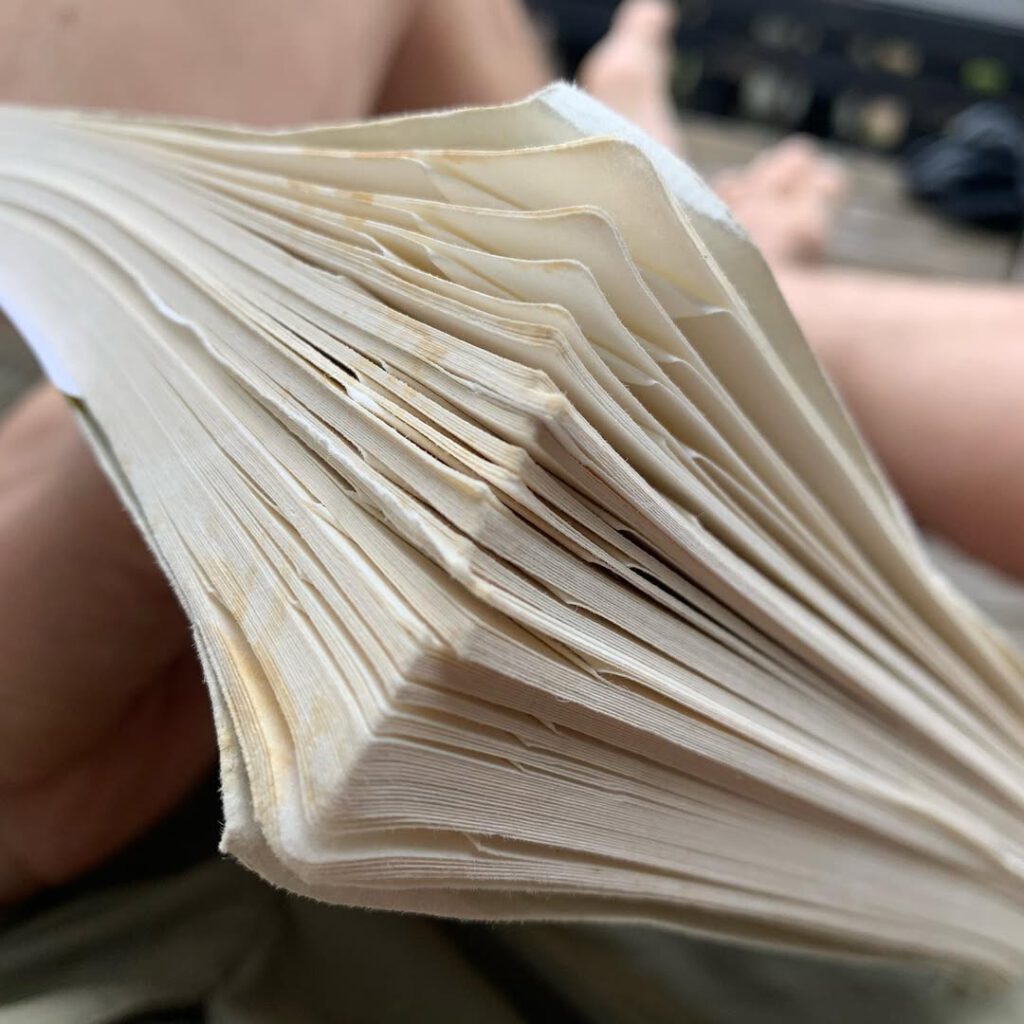


Comme un fantôme qui vous hante.
Mais bienveillant. Et accueillant. Et magnifique dans son austère indifférence. Il n’y avait pas à lutter contre lui, juste apprendre à le connaître, et réaliser que c’était lui qui changeait, doucement, tranquillement, à un rythme qu’il était parfois impossible de percevoir mais dont le glissement rendait souvent flagrante la permanence de l’être.
Mais bienveillant. Et accueillant. Et magnifique dans son austère indifférence. Il n’y avait pas à lutter contre lui, juste apprendre à le connaître, et réaliser que c’était lui qui changeait, doucement, tranquillement, à un rythme qu’il était parfois impossible de percevoir mais dont le glissement rendait souvent flagrante la permanence de l’être.
Le Vent des plaines, 2018 (extrait)
…
peut-être as-tu raison de t’en aller
sans rien me dire
sans rien me dire
Luisance, (extrait)
…
Le bus partit et Juan le regarda s’éloigner vers l’autoroute dans un brouillard de poussière sèche. Il ouvrit le paquet, y trouvant une petite toile brodée où il reconnut immédiatement le mur frontière, les courbes de niveaux, les routes qui remontaient depuis Nogales et un écrou fracturé qui surplombait le tout et qui pouvait représenter à la fois la libération et la séparation. Ou peut-être les rêves brisés qui constituaient un nouveau départ à partir du moment où on le choisissait. Et, au-dessous de l’ensemble, Carmen avait placé quelques mots tout simples mais où il reconnut une phrase qu’il avait prononcée devant elle : « Les chauves-souris s’envolent vers les étoiles. » Et il se mit à pleurer.
American Dreamer, Éditions courtes et longues, 2019 (extrait)
…
la plage devant moi, la fin du territoire, la fin du continent, la terre qui devient sable, se fragmente,
s’effrite, se désagrège puis disparaît sous l’eau, les vagues, l’écume, le mouvement perpétuel
j’ai toujours imaginé le début du monde ainsi :
des vagues qui s’abandonnent, la plage à perte de vue, le lien, le lieu de rencontre entre le liquide et le solide, l’échange et le reflux, l’union et la séparation, le soleil, l’astre, le silence, la lumière,
la non-conscience
l’être qui nait ne sait rien, il est attente, contemplation
j’ai toujours imaginé le début du monde ainsi :
des vagues qui s’abandonnent, la plage à perte de vue, le lien, le lieu de rencontre entre le liquide et le solide, l’échange et le reflux, l’union et la séparation, le soleil, l’astre, le silence, la lumière,
la non-conscience
l’être qui nait ne sait rien, il est attente, contemplation
désagrège, (extrait)
…
– J’ai dû changer, Abuelo.
– On ne change jamais tant que ça.
– Ça fait vingt ans. J’étais un enfant.
– Vingt ans, déjà ?
– Je suis désolé, Abuelo. »
Le grand-père posa sa main sur celle de son petit-fils.
« Je sais que tu vis loin. »
Il s’arrêta encore.
« Mais tu as eu raison de revenir. »
L’un et l’autre se turent pendant quelques instants.
« Tu veux un verre de mezcal ?
– À cette heure-ci ?
– On a bien le droit, une fois tous les vingt ans… »
– On ne change jamais tant que ça.
– Ça fait vingt ans. J’étais un enfant.
– Vingt ans, déjà ?
– Je suis désolé, Abuelo. »
Le grand-père posa sa main sur celle de son petit-fils.
« Je sais que tu vis loin. »
Il s’arrêta encore.
« Mais tu as eu raison de revenir. »
L’un et l’autre se turent pendant quelques instants.
« Tu veux un verre de mezcal ?
– À cette heure-ci ?
– On a bien le droit, une fois tous les vingt ans… »
American Dreamer, Éditions courtes et longues, 2019 (extrait)
…
« Cette histoire n’est rien. Un moment volé au temps. Quelques heures entre l’Atlantique et Détroit, suspendues dans la chaleur de l’été au-dessus de l’asphalte désagrégé des rues. Le rêve d’une ville en décadence, la vitrine de nos échecs et de nos faillites, le fossé dans lequel on ne cesse de jeter les corps dépecés des exclus et des abandonnés. Le monde tel qu’il est. Un chaos perpétuellement renouvelé que nous cherchons sans cesse à rationaliser pour lui donner un sens et satisfaire notre fantasme d’équilibre. Et au creux duquel nous inventons nos vies. »
Tout s’écoule, Éditions Bartillat, 2023 (extrait)
…
une photo sur Instagram,
ton fil qui s’évapore dans les montagnes fumeuses de Caroline du Nord
pourquoi l’as-tu postée au monde plutôt que de me la transmettre, à moi ?
quel égoïsme dans l’amour, quel égocentrisme (le mien)…
j’annule la possibilité de ton existence aux autres
te laisser reprendre ton souffle,
ne pas t’effrayer,
peut-être es-tu déjà mort à notre amour – quel droit ai-je de prononcer ce mot dans le doute –, à ce désir que tu inventes pour moi, je me laisse porter par le mirage
ton fil qui s’évapore dans les montagnes fumeuses de Caroline du Nord
pourquoi l’as-tu postée au monde plutôt que de me la transmettre, à moi ?
quel égoïsme dans l’amour, quel égocentrisme (le mien)…
j’annule la possibilité de ton existence aux autres
te laisser reprendre ton souffle,
ne pas t’effrayer,
peut-être es-tu déjà mort à notre amour – quel droit ai-je de prononcer ce mot dans le doute –, à ce désir que tu inventes pour moi, je me laisse porter par le mirage
Luisance, (extrait)
…