Hier soir, je regarde enfin La pudeur ou l’impudeur que je trouve magnifique évidemment, notamment ce que Christophe Honoré dont je visionne après le film un entretien appelle la violence, mais, dans les scènes où Guibert demande à ses tantes âgées ce qu’elles pensent du suicide, je trouve aussi une intimité folle, il leur parle comme à des êtres sensibles, il les interroge sur leur rapport au corps, notamment sa tante Suzanne qui peine lorsqu’elle est nourrie à la cuiller devant la caméra et qui, d’un souffle lorsqu’il lui demande ce qu’elle souhaiterait pour son anniversaire à venir, murmure un « un peu plus de temps à vivre » qui trahit à la fois la crainte de la fin et l’attachement à ce qui reste d’existence. Il nous défie aussi de le regarder, de vivre comme il vit, comme il a vécu, ne pas se laisser berner par les illusions que sont les convenances, on chie tous donc pourquoi se cacher, pourquoi ne pas parler de la maladie, pourquoi ne pas se montrer dans les diarrhées qui sont l’apanage de son angoisse, de la déliquescence du corps, pourquoi avoir peur de dire les choses, de les filmer, il sait que son entreprise est une philosophie, que les limites que nous posons à l’énoncé de ce qui peut se dire ou ne pas se dire agit comme une hache qu’on planterait dans un tronc, elle prépare la séparation, la dis-jonction, on ne peut vivre l’intimité qu’en disant tout, en montrant tout.
Et, pourtant, nous savons que nous ne montrons jamais tout. Non pas par duplicité mais par incapacité. On rejoint là l’un des grands enjeux de la littérature : comment mimer le réel, comment faire coller le récit à l’existence, comment détacher la narration de sa gangue à voie trop étroite comme un train qui passerait dans un tunnel, et l’épanouir dans une réalité où le chevauchement des perceptions ajuste en permanence la focale, la prise de vue, le panorama, comment aller au-delà des outils que nous, humanité, avons conçu et qui nous enferment. Comment sinon en commençant par montrer et regarder.











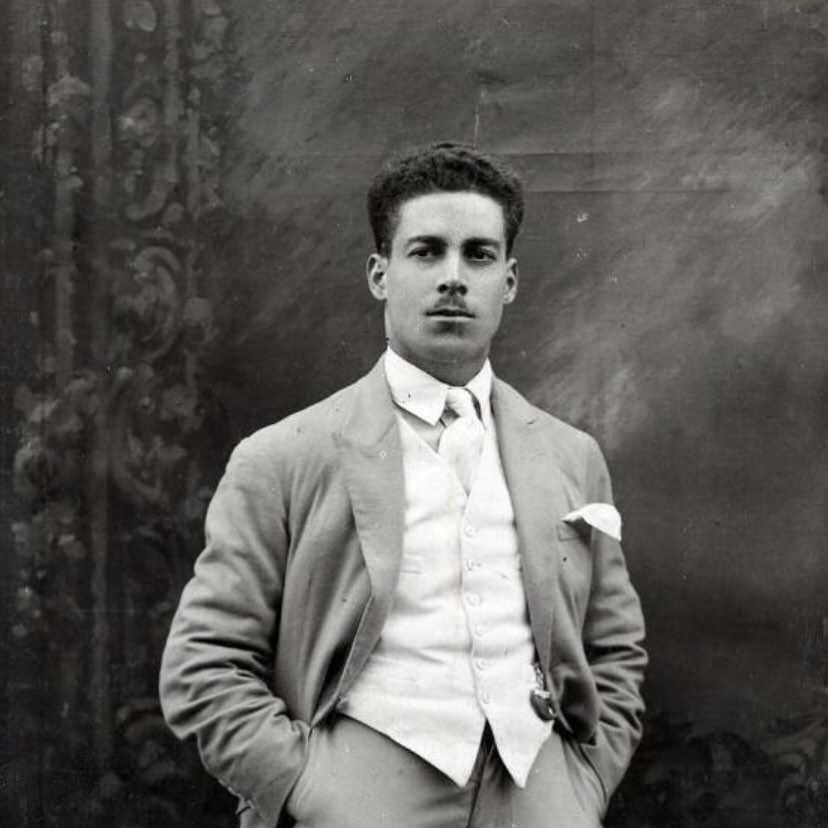





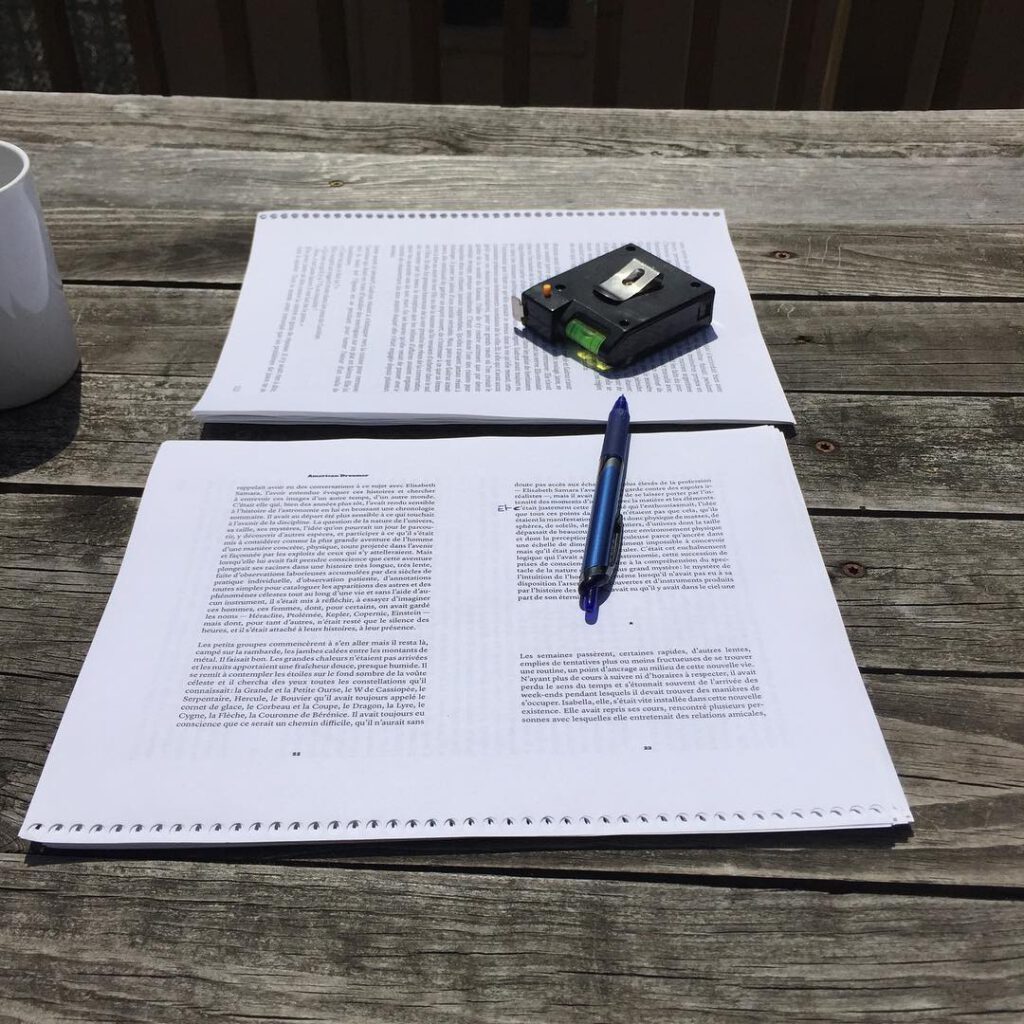
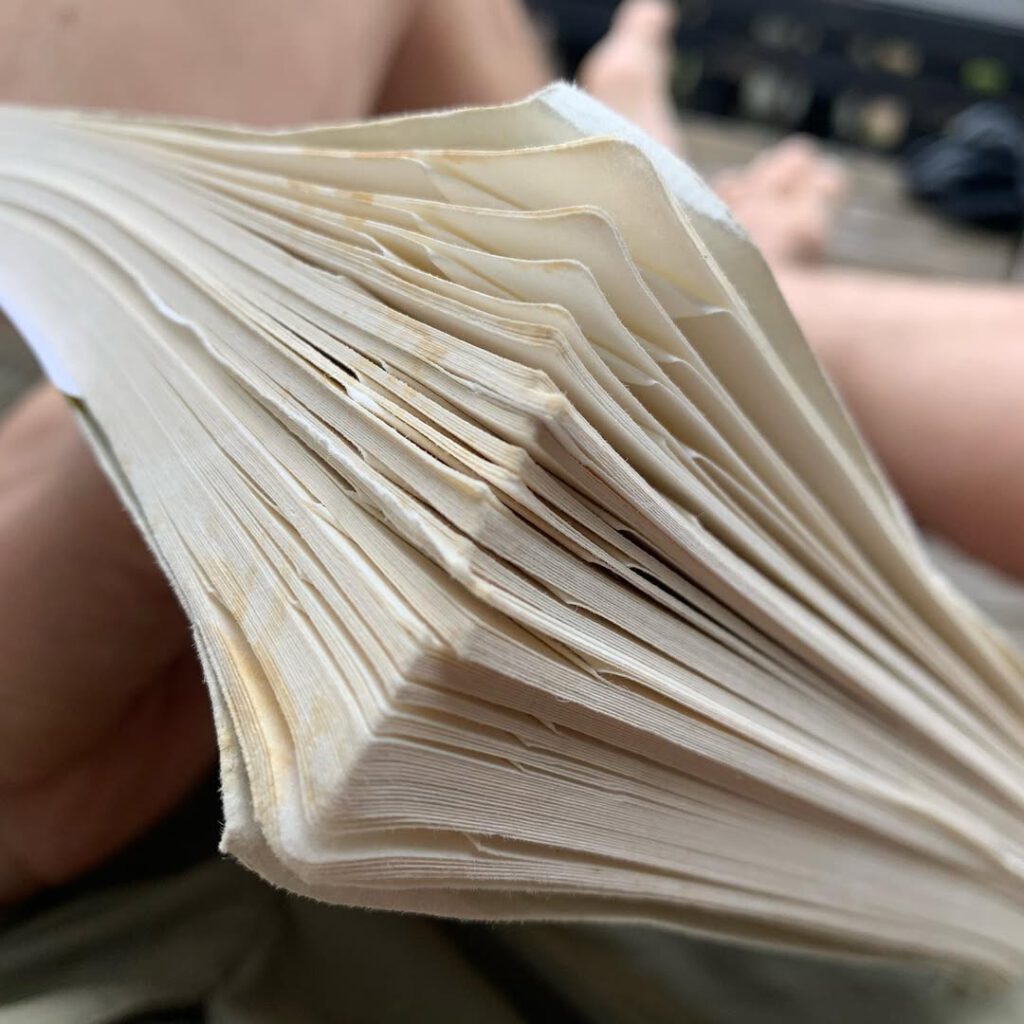


Comme un fantôme qui vous hante.
Mais bienveillant. Et accueillant. Et magnifique dans son austère indifférence. Il n’y avait pas à lutter contre lui, juste apprendre à le connaître, et réaliser que c’était lui qui changeait, doucement, tranquillement, à un rythme qu’il était parfois impossible de percevoir mais dont le glissement rendait souvent flagrante la permanence de l’être.
Mais bienveillant. Et accueillant. Et magnifique dans son austère indifférence. Il n’y avait pas à lutter contre lui, juste apprendre à le connaître, et réaliser que c’était lui qui changeait, doucement, tranquillement, à un rythme qu’il était parfois impossible de percevoir mais dont le glissement rendait souvent flagrante la permanence de l’être.
Le Vent des plaines, 2018 (extrait)
…
peut-être as-tu raison de t’en aller
sans rien me dire
sans rien me dire
Luisance, (extrait)
…
Le bus partit et Juan le regarda s’éloigner vers l’autoroute dans un brouillard de poussière sèche. Il ouvrit le paquet, y trouvant une petite toile brodée où il reconnut immédiatement le mur frontière, les courbes de niveaux, les routes qui remontaient depuis Nogales et un écrou fracturé qui surplombait le tout et qui pouvait représenter à la fois la libération et la séparation. Ou peut-être les rêves brisés qui constituaient un nouveau départ à partir du moment où on le choisissait. Et, au-dessous de l’ensemble, Carmen avait placé quelques mots tout simples mais où il reconnut une phrase qu’il avait prononcée devant elle : « Les chauves-souris s’envolent vers les étoiles. » Et il se mit à pleurer.
American Dreamer, Éditions courtes et longues, 2019 (extrait)
…
la plage devant moi, la fin du territoire, la fin du continent, la terre qui devient sable, se fragmente,
s’effrite, se désagrège puis disparaît sous l’eau, les vagues, l’écume, le mouvement perpétuel
j’ai toujours imaginé le début du monde ainsi :
des vagues qui s’abandonnent, la plage à perte de vue, le lien, le lieu de rencontre entre le liquide et le solide, l’échange et le reflux, l’union et la séparation, le soleil, l’astre, le silence, la lumière,
la non-conscience
l’être qui nait ne sait rien, il est attente, contemplation
j’ai toujours imaginé le début du monde ainsi :
des vagues qui s’abandonnent, la plage à perte de vue, le lien, le lieu de rencontre entre le liquide et le solide, l’échange et le reflux, l’union et la séparation, le soleil, l’astre, le silence, la lumière,
la non-conscience
l’être qui nait ne sait rien, il est attente, contemplation
désagrège, (extrait)
…
– J’ai dû changer, Abuelo.
– On ne change jamais tant que ça.
– Ça fait vingt ans. J’étais un enfant.
– Vingt ans, déjà ?
– Je suis désolé, Abuelo. »
Le grand-père posa sa main sur celle de son petit-fils.
« Je sais que tu vis loin. »
Il s’arrêta encore.
« Mais tu as eu raison de revenir. »
L’un et l’autre se turent pendant quelques instants.
« Tu veux un verre de mezcal ?
– À cette heure-ci ?
– On a bien le droit, une fois tous les vingt ans… »
– On ne change jamais tant que ça.
– Ça fait vingt ans. J’étais un enfant.
– Vingt ans, déjà ?
– Je suis désolé, Abuelo. »
Le grand-père posa sa main sur celle de son petit-fils.
« Je sais que tu vis loin. »
Il s’arrêta encore.
« Mais tu as eu raison de revenir. »
L’un et l’autre se turent pendant quelques instants.
« Tu veux un verre de mezcal ?
– À cette heure-ci ?
– On a bien le droit, une fois tous les vingt ans… »
American Dreamer, Éditions courtes et longues, 2019 (extrait)
…
« Cette histoire n’est rien. Un moment volé au temps. Quelques heures entre l’Atlantique et Détroit, suspendues dans la chaleur de l’été au-dessus de l’asphalte désagrégé des rues. Le rêve d’une ville en décadence, la vitrine de nos échecs et de nos faillites, le fossé dans lequel on ne cesse de jeter les corps dépecés des exclus et des abandonnés. Le monde tel qu’il est. Un chaos perpétuellement renouvelé que nous cherchons sans cesse à rationaliser pour lui donner un sens et satisfaire notre fantasme d’équilibre. Et au creux duquel nous inventons nos vies. »
Tout s’écoule, Éditions Bartillat, 2023 (extrait)
…
une photo sur Instagram,
ton fil qui s’évapore dans les montagnes fumeuses de Caroline du Nord
pourquoi l’as-tu postée au monde plutôt que de me la transmettre, à moi ?
quel égoïsme dans l’amour, quel égocentrisme (le mien)…
j’annule la possibilité de ton existence aux autres
te laisser reprendre ton souffle,
ne pas t’effrayer,
peut-être es-tu déjà mort à notre amour – quel droit ai-je de prononcer ce mot dans le doute –, à ce désir que tu inventes pour moi, je me laisse porter par le mirage
ton fil qui s’évapore dans les montagnes fumeuses de Caroline du Nord
pourquoi l’as-tu postée au monde plutôt que de me la transmettre, à moi ?
quel égoïsme dans l’amour, quel égocentrisme (le mien)…
j’annule la possibilité de ton existence aux autres
te laisser reprendre ton souffle,
ne pas t’effrayer,
peut-être es-tu déjà mort à notre amour – quel droit ai-je de prononcer ce mot dans le doute –, à ce désir que tu inventes pour moi, je me laisse porter par le mirage
Luisance, (extrait)
…
