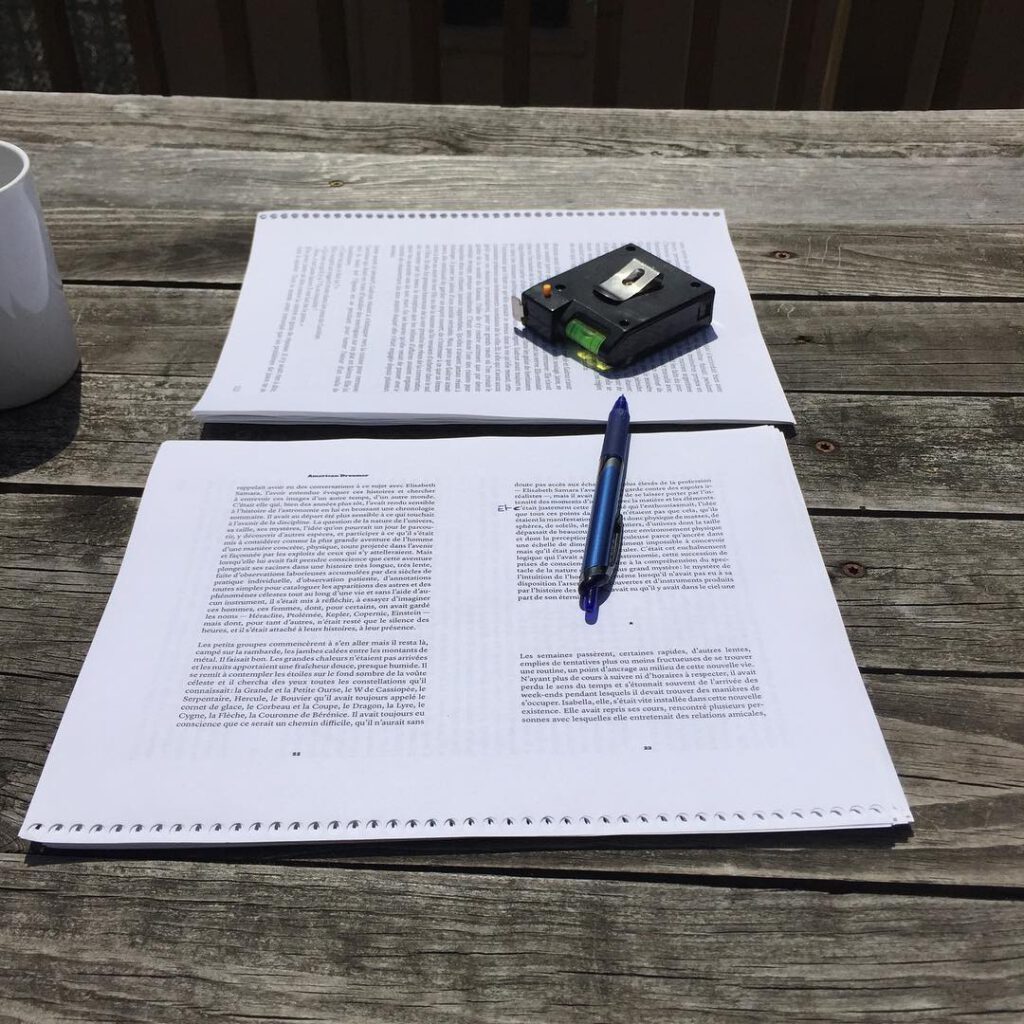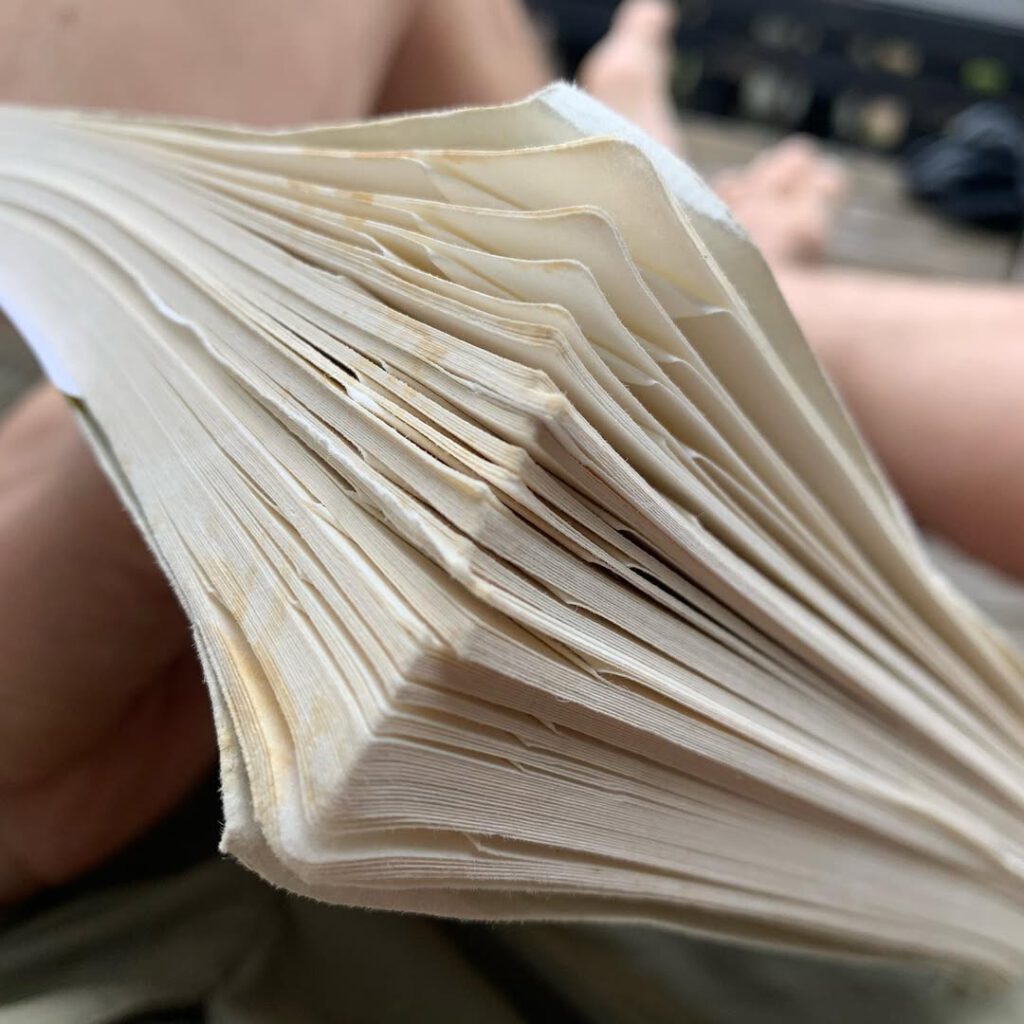Être là, sous les pins, les cigales, face à la mer, une expérience singulière toujours renouvelée. Je lis le vers que Barbedette cite de Baudelaire, « sois sage, ô ma douleur »,
cela en appelle d’autre, celui de Yourcenar,
« que rien, ni le temps, d’autres amours, ni l’âge, n’empêcheront jamais que vous ayez été »,
et puis le
« c’est une chose étrange à la fin que le monde », le texte d’Aragon qu’il est impossible de se remémorer sans entendre la voix de Jean d’Ormesson.
J’aimerais savoir ne me nourrir que de cela, ou trouver l’équilibre qui nous échappe toujours, celui où l’on pourrait travailler suffisamment avant d’aller marcher, courir, rencontrer des gens, aimer, jouir de sa solitude puis manger avec des amis et des amants, se coucher contenté des milles plaisirs, des milles sensations de la vie. Cela chaque jour. Non pas comme de petites fenêtres étriquées mais des paysages amples, une infinité soumise et libérée du temps. Soumise et libérée. Mais pas libérée du corps. Je ne veux plus vivre que dans ce corps, ma seule présence au monde. On m’a menti lorsqu’on m’a dit qu’il fallait le dépasser, le combattre, le vaincre. J’aime et veux aimer ce corps par-dessus tout comme je veux aimer le monde où j’ai enfin la joie d’habiter.
Julie au déjeuner nous parle de la fosse qui voisine la baie de Cassis et explique en partie la fraicheur de la mer et des plages locales.
Pourtant, cela :
la conscience cruelle sur laquelle Nan Goldin essaie de nous alerter avec Edouard Louis, à Arles hier ou lundi soir. Gaza. Ses morts. L’horreur. La fausse victimisation derrière laquelle se retranche en ce moment Israël ou ce que nous entendons d’Israël – ici, toujours se remémorer que les nations n’existent pas, elles sont des concepts recouvrant des réalités mouvantes, des entités bruissantes de couleurs et de spectres infinis, mais auxquelles nous donnons la forme d’êtres entiers. Et cela est vrai aussi bien d’Israël que de Gaza, de la France que des États-Unis ou de la Suède. Donc: les Gazaouis meurent. Comme les Israéliens sont morts. L’un et l’autre au même plan. À la même exacte place. On ne peut pas pleurer les morts d’Israël sans se dresser d’horreur face à ce qui se passe à Gaza. On ne peut pas invoquer le 7 octobre pour défendre l’horreur qui se déploie depuis. La souffrance et la mort n’ont pas d’explication, ne doivent pas avoir d’explication. Elles sont intolérables. Nous ne les tolérons parce que nos esprits ont trop appris à raisonner. Le 7 octobre est maintenant de l’histoire, sauf pour les quelques otages qui restent prisonniers s’ils sont encore en vie. La souffrance et la mort de Gazaouis, d’enfants, de femmes, la torture à laquelle ils sont soumis est intolérable. Rien ne peut la justifier. Je ne sais pas quoi faire. On nous dit de dire ce que l’on a dit cent fois alors je le redis. Comme une invocation. Avec la crainte que cela ne soit que comme les vessies natatoires de ces mostelles qu’on vend sur le port de Cassis après le retour des petits bateaux de pêches, gonflées d’air devenu inutile face à la fixité de la chair. Redire : les morts de Gaza, la souffrance de Gaza.