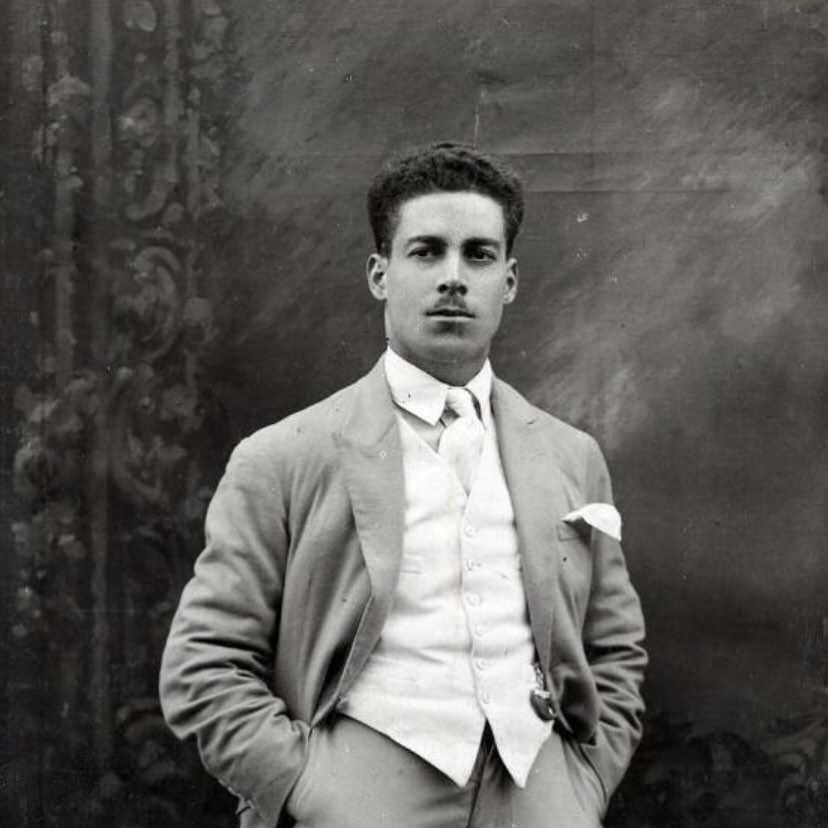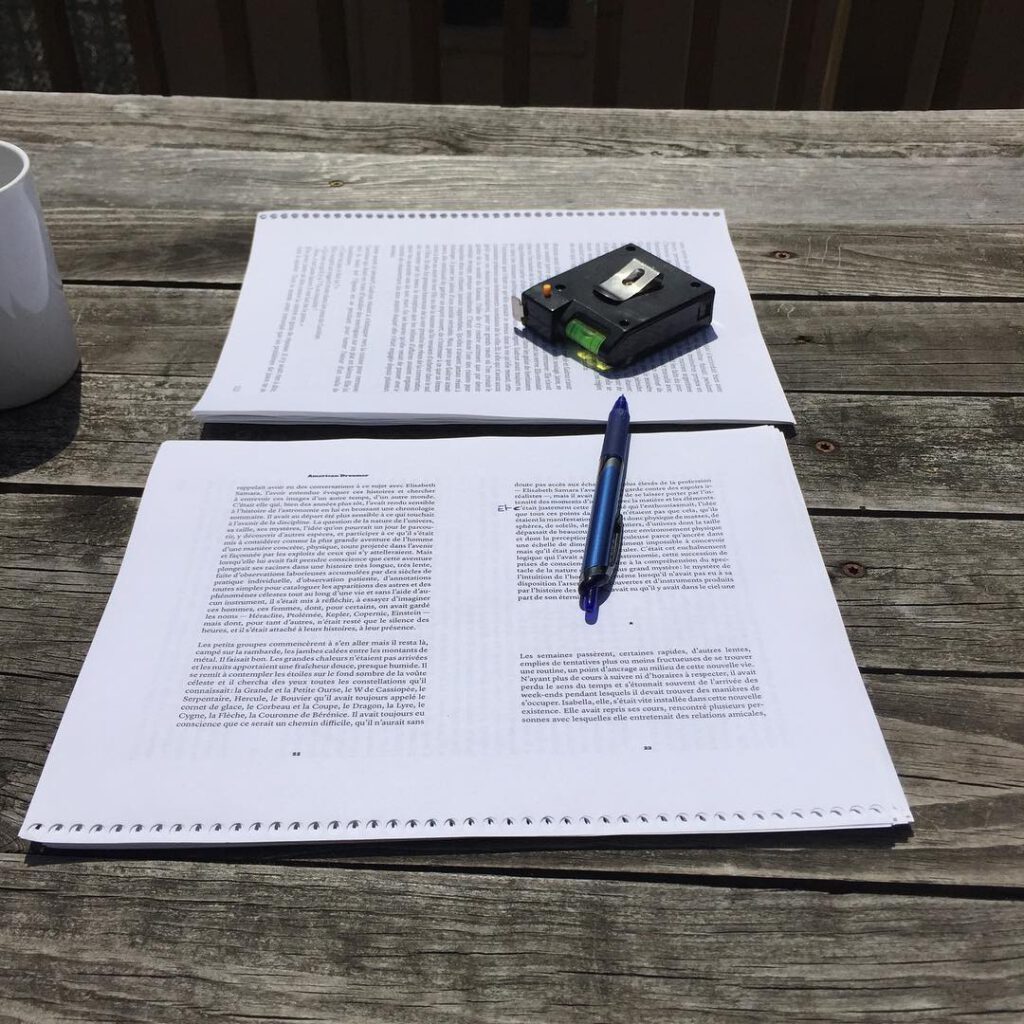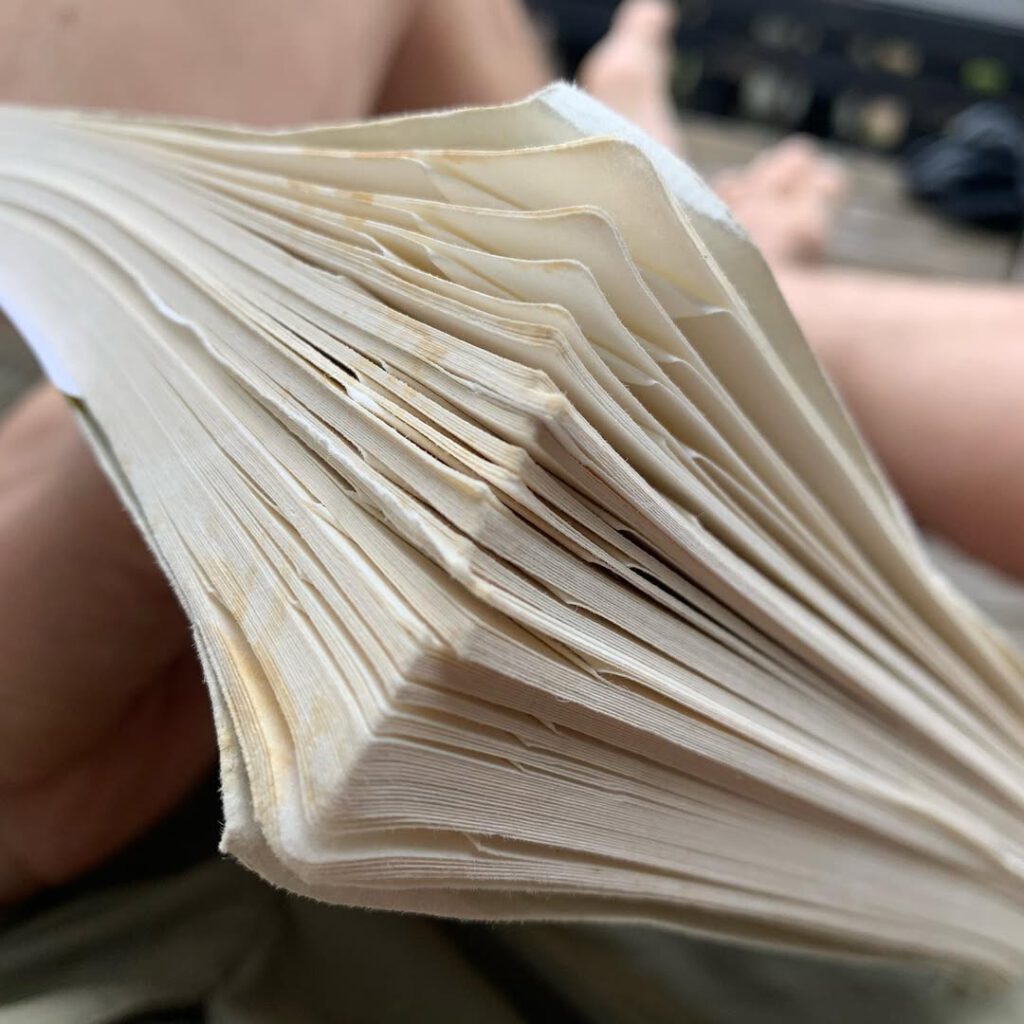(publié dans Connaissance des Arts, septembre 2022)
…
Singulière aventure picturale que celle de de Gérard Garouste : il arrive à l’école des Beaux- Arts juste avant 1968, au moment où l’on redéfinit les canons de l’enseignement artistique, où l’on retire les sculptures classiques du hall vitré de l’école, et où se structurent et s’affirment, en France comme ailleurs, des mouvements de questionnement formel très forts de la pratique artistique.. L’heure est à l’art minimal et conceptuel, à Supports/Surfaces, à la performance, à l’Arte Povera. Garouste observe et apprend, il suit des cours de peinture à l’atelier Singier, il découvre Duchamp aussi sous la plume de Pierre Cabane et comprend immédiatement l’audace du postulat. Il en perçoit ses limites aussi, le danger d’une avant-garde devenue académique qui ne vit plus que sous l’injonction de la nouveauté. « Quand tous les chemins s’ouvrent, dira-t-il, il n’y a plus de chemin ». D’où un sentiment de malaise et de décalage pour celui qui s’était destiné à la peinture classique.
Sa première exposition, en 1969, est suivie d’une recherche picturale qui a un certain lyrisme expressionniste mais c’est un rêve qui vient ancrer la première véritable intuition picturale de l’artiste: un rêve comme dans les songes bibliques et dans lequel se promènent deux personnages qu’il se met à nommer le classique et l’Indien. Garouste y voit une réponse à ses questions, la nécessité fondamentale de la présence concomitante de l’intuitif et du cérébral, de l’inconscient et du conscient. Assez vite, il explore aussi d’autres pistes, notamment le dessin graphique et la scénographie avec Jean-Michel Ribes, un ancien camarade d’école. Il s’essaie au théâtre, écrit une pièce qu’il produit au Palace où il a rencontré le légendaire Fabrice Emaer. Il expérimente. À ses décors de théâtre inspirés par une Italie fantasmée répond un cycle de peintures inspirées du baroque et à la mise en scène évidente: une série de onze toiles composent la Comédie policière de 1978 où un homme, une femme, un enfant et un chien habitent des espaces imprécis. Dans le jeu de piste et de questions qui s’ouvrent alors se dessine le rejet du sujet alibi et donc la remise au premier plan de la question de l’essence de la peinture. Garouste se rapproche de l’objet de sa quête.
Car c’est bien d’une quête qu’il s’agit. À rebours de la critique et des passions du moment, il se lance dans une exploration attentive des grands maîtres. Il retourne à l’âge d’or, au XVIe et au XVIIe siècles, au Tintoret, à Greco, à Velasquez, il s’intéresse à la technique qui rend possible la toile, les empâtements, les glacis, il observe les styles, les sujets. Entre-temps, il a lu Barthes et ses Mythologies, et il s’approprie un language, des archétypes, il fusionne sa fiction personnelle et celle des grandes figures de la conscience humaine. Le mythe d’Orion devient un cycle, les figures d’Orthros, le chien bicéphale, ou d’Atropos, l’une des moires et déesse de la destinée, jouxtent d’autres figures de la mythologie comme Adhara, l’étoile binaire de la constellation du chien, dans des paysages qui s’assombrissent. Partout, la manière se fait plus allusive mais les échos, les résonances deviennent plus évidentes.
C’est au même moment que Garouste commence à exposer à la galerie Durand-Dessert à Paris puis chez Leo Castelli, le grand marchand new-yorkais dont la protection lui vaut une première reconnaissance internationale. Malgré les encouragements de ce dernier à venir s’installer aux États-Unis, il choisit de demeurer en Europe et s’installe même en Normandie, dans le grand atelier de Marcilly-sur-Eure qui devient son domaine. Là naissent de grandes compositions, des natures mortes, des nus, La Barque, le pêcheur et le pantalon rouge ou le Commandeur et la maison rose qui sont à la fois des provocations vis-à-vis du monde de l’art et une exploration permanente des grands archétypes de la peinture.
La vie d’un artiste est faite de rencontres. Celle de la Divine Comédie de Dante que Garouste lit dans une traduction de Jacqueline Risset en 1985 apporte un nouveau jalon au jeu de codes et de significations dont son oeuvre s’était nourrie jusque-là. Elle l’illumine d’une source inépuisable et vertigineuse d’histoires, de renvois, de scènes dont les variations offrent la possibilité d’une errance sans fin. Garouste parle des mots, de littérature, il côtoie Kafka, Rabelais, Cervantès, les textes de l’Antiquité et de la Bible évidemment mais, avec Dante, dit-il, il trouve le sujet qu’il avait toujours cherché, il touche au jeu de codes et de significations dont se nourrit la pensée, à la quête permanente de l’individu dont les mots forment le socle imparfait et incertain mais incontournable.
En parallèle, il répond à des commandes publiques, il expose à Beaubourg puis au CAPC et à la fondation Cartier. Il peint aussi des Indiennes, de grandes toiles flottantes dont le mouvement répond à l’environnement dans lequel elles sont placées et qui offrent de nouvelles possibilités de narration linéaire. Dans ces dernières, il explore la Genèse, l’Exode, le livre de Job, d’autres signes, de nouveaux signes. Toujours des signes. Car Garouste est avant tout un peintre du signe, de la figuration qui se comprend comme véhicule d’un sens plus vaste, plus universel, qui se sait appartenir à un système sans fin dont le but ultime est la connaissance. On a parfois voulu faire de lui un chef de file du post-modernisme mais il n’est pas chef-de-file, il est jalon, il est prophète, il est miroir qui renvoie à l’infini le message de questionnement fondamental de la peinture et donc de l’existence. Et de cela vient évidemment la prolixité du discours, la répétition permanente des thèmes, des personnages, des citations, les jeux de lecture qui se s’emmêlent et se superposent.