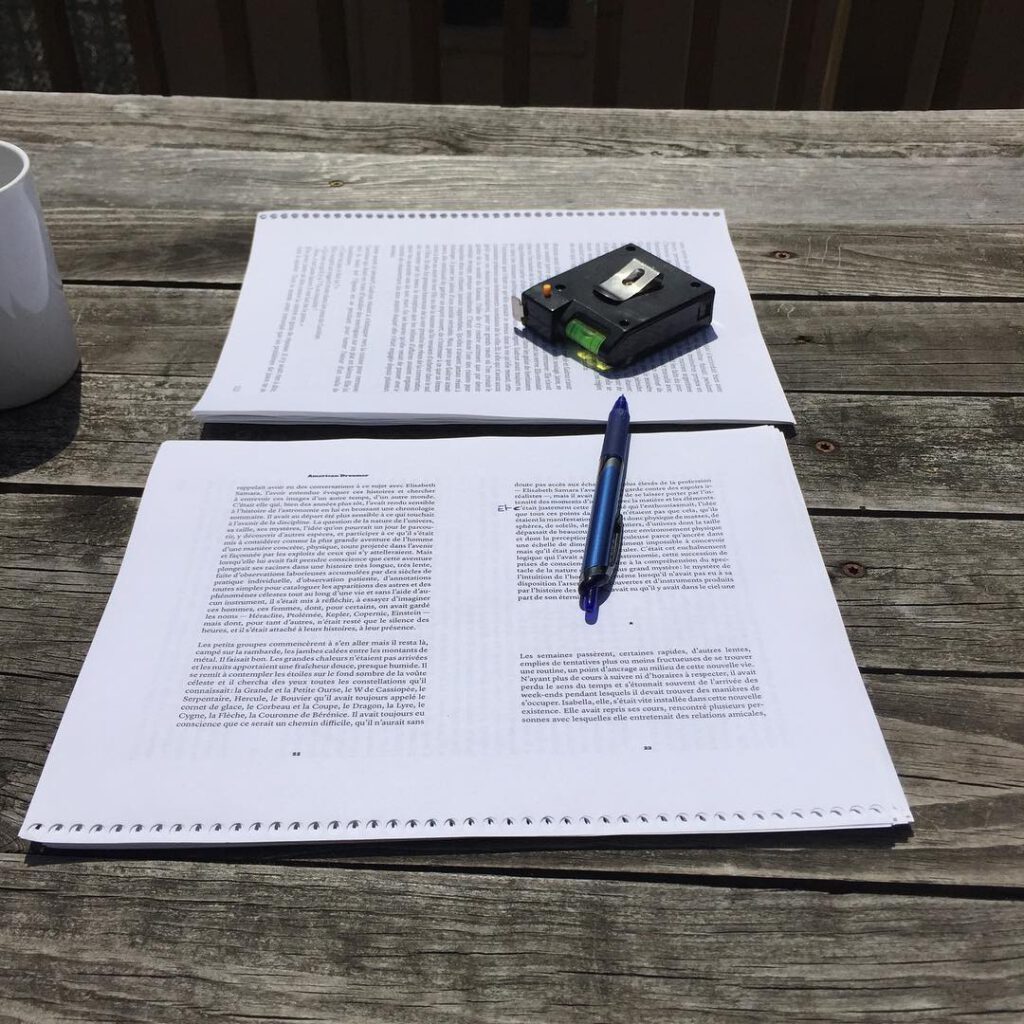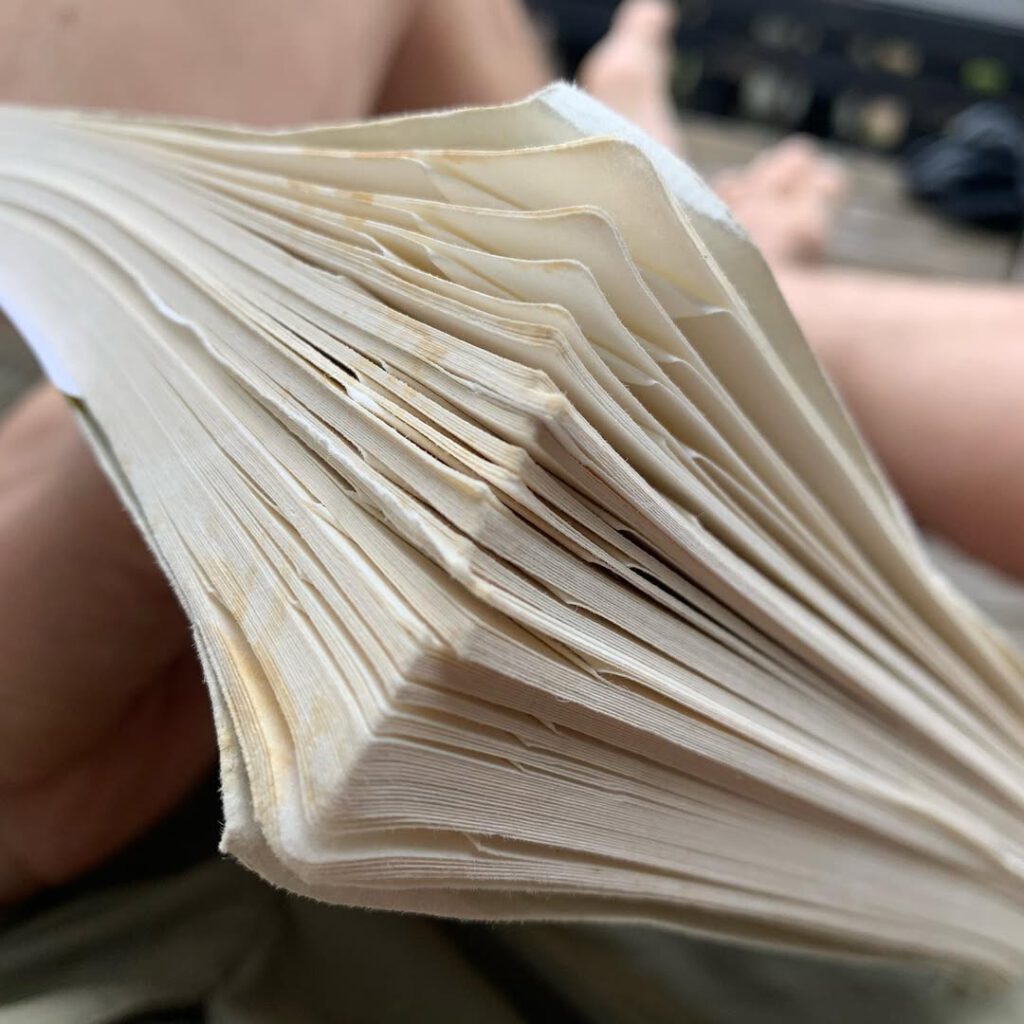(publié dans PREF Magazine sous forme de roman-feuilleton, Juin 2006)
…
Fut-ce quelque chose qui changea soudain en moi ? Ou simplement les effets du K qui resurgirent ? Je me vis l’un d’eux, abandonné aux caresses de leurs trois corps entrelacés, me livrant à la sensualité du groupe et au désir de ces hommes que j’allais dans un même mouvement contenter et dominer. Je me perdis dans les innombrables détails de leur beauté, ne sachant choisir entre l’adoration éperdue des corps et le besoin irrépressible de consommer mon union avec eux. J’aurais voulu que ce moment dure toujours, qu’il devienne mon être même. Je vis dans les yeux de ces hommes le désir qui m’animait aussi et je trouvai dans notre union à quatre la possibilité d’exister enfin.
Sur le sable, Steven traçait d’un geste lent et précis de petites ornières qui dessinaient le signe mathématique de l’infini. La journée avait passé, lumineuse et immobile, comme tous ces dimanches de l’été où le bourdonnement d’un insecte semble emplir à lui seul le vide extraordinairement bleu du ciel. La mer devant nous était étale, le soleil miroitait sur les flots souples comme les carreaux épars d’une mosaïque d’or, et mon regard se perdit dans cette ondulation hypnotique, bien au-delà de tous les garçons qui marchaient le long de la plage mais que je ne voyais plus. Alors que je me reposais dans ce spectacle sublime, tout comme, enfant, j’aurais pu passer des heures à observer les blés sur la plaine de Beauce, ils passaient, en groupes de trois ou cinq, d’un pas langoureux et qui se voulait nonchalant, engagés dans des discussions sans fin et toutes apparemment semblables. D’un œil faussement distrait, ils surveillaient aussi la plage et observaient ceux qui, comme nous, profitaient du moment. Ainsi, habillée de maillots flamboyants, la moitié de l’île regardait l’autre moitié défiler, comme dans une parade de Quatorze-Juillet dessinée par Sempé où l’on aurait pu saisir les traits de chacun des personnages et trouver ici le regard fier d’un chef de fanfare, et là l’expression jalouse d’un mari surveillant sa femme alors qu’elle sourit à un jeune homme penché à son balcon. L’espace d’un instant, je vis dans le mouvement tranquille des corps, dans la répétition des pas, dans ce que je percevais des conversations, émaillées de traits sans conséquences et de rires, dans ce mélange étrange de promenade désœuvrée et d’exhibitionnisme, l’exacte réplique des scènes dominicales du Bois de Boulogne que Proust décrit dans La Recherche, et où les dames de Paris, accompagnées de leurs enfants, marchent d’un pas indolent mais mesuré, autant pour se distraire que pour être aperçues.
A côté de moi, Steven continuait à passer son doigt sur le sable. Il était tout entier plongé dans la sensation que lui procurait son geste, heureux comme un enfant et oublieux du monde alentour. Ses yeux bleus brillaient doucement, comme au rythme des vagues. Je regardais sa peau bronzée, les courbes de ses épaules, de sa poitrine, tout son corps alangui. J’admirais son calme et sa douceur. Il avait toujours été pour moi un compagnon apaisant, l’un de ces êtres qui vous regardent de tous leurs yeux lorsque vous parlez, et aussi l’un de ceux qui savent ne pas être inquiets du silence. Nous avions construit une amitié simple dont je savais pourtant qu’elle disparaîtrait sans doute comme elle était arrivée. Nous nous étions rencontrés dans un bar de New York, un soir d’hiver. Nous aimions nous voir, discuter, nous partagions le même mode de vie et quelques amis, il était beau et j’imagine qu’il pensait la même chose de moi. Notre amitié ressemblait à ce tracé dans le sable. Elle était simple et sensuelle, douce aussi, mais elle s’effacerait progressivement sans que nous en ayons conscience. La douceur de cette après-midi passée ensemble tenait peut–être à cela, à l’absence de durée, à l’absolue nécessité de n’exister que dans l’instant présent parce qu’elle n’avait ni passé ni avenir. Elle aurait pu être répétée sans fin, chaque semaine, chaque année, sans jamais changer, sans avoir jamais besoin d’un complément. Steven pourrait être à côté de moi l’année suivante et passer encore son doigt dans le sable, de la même exacte manière, et nous discuterions des mêmes choses, commentant le passage des garçons devant nous et attendant calmement la fin de la journée, sans autre but. Steven était l’un de ces amis que j’avais toujours désiré, l’un de ces garçons qui vous font réaliser que vous appartenez au monde gay new-yorkais parce qu’ils en sont les atlantes. Mais je savais, sans toutefois vouloir me l’exprimer, qu’il était une illusion issue de mon désir, une image à laquelle je ne pourrais pas m’attacher, lisse et parfaite comme la peau de son torse, au creux de laquelle je me serais allongé pour me reposer et me laisser aller à penser que la vie pouvait être simple. Un jour prochain, il aurait disparu, et, avec lui, tous les garçons dont j’avais un jour espéré qu’ils deviendraient des amis alors qu’ils n’étaient eux aussi que les reflets miroitants d’une certaine idée que j’avais rêvée de ma vie.
Mais là, dans la lumière dorée du mois d’août, pourquoi me serais-je imposé à moi-même de ne pas profiter de la douceur du jour, de la sensualité des regards, de la sensation étourdissante d’appartenir à une communauté, et pourquoi aurais-je refusé mon rôle dans ce grand théâtre du bord de mer où les seuls acteurs étaient des figurants ?
Les lignes qu’avait tracées Steven me rappelaient mon enfance et les heures que je passais à créer dans le sable des univers entiers, des vallées ondoyantes, des routes sur lesquelles une voiture circulait à vive allure pour tenter d’échapper à l’effritement continu du terrain après le passage de mes doigts. Par moment, mes deux mains plongeaient dans le sable, soulevant le terrain comme si elles avaient été d’immenses monstres invisibles, puis je les conduisais dans les flots où elles devenaient des vaisseaux fiers et bravant les vagues de l’océan alors que de ma paume j’effleurais la surface de l’eau. Quelles heures merveilleuses je passais, seul, à imaginer ces histoires qui mêlaient la sensation visuelle et tactile du monde alentour et la vision que je me faisais déjà de la vie, de ses défis, des rêves de grandeur et d’action que j’avais pour moi-même, et qui se transformaient en de vertigineuses épopées où mon désir était créateur. De quels fascinants pouvoirs mon imagination d’enfant était-elle dotée! Alors, voyant autour de moi les corps trop parfaits de ces hommes que j’avais tous désirés, je réalisais soudain ce qui l’avait remplacée : le fantasme et son absolue domination sur tout l’univers de ma vie.
Une foule de sentiments et de souvenirs m’envahit alors. Je crus retrouver ce jeune adolescent aux cheveux blonds et à la démarche presque féminine qui participait à un rassemblement des familles chrétiennes à Paray-le-Monial. Je reconnus immédiatement la douleur aigüe qui m’étraignait chaque fois que je voyais notre chef d’équipe, un jeune homme qui devait avoir vingt ans et devant lequel j’aurais voulu m’évanouir pour qu’il me prenne dans ses bras et m’emmène à l’écart. Dans ma tête, les images étaient accompagnées de sensations physiques que je n’avais jamais connues mais qui se révèleraient être très exactement celles que je rechercherais plus tard. Il ne s’agissait pas d’un conte pour enfant, c’était devant mes yeux une scène plus réelle que tous ces gens assemblés autour de moi, et qui commandait à mon être tout entier. Je revoyais aussi mes premiers jeans, et cette sensation indéfinissable que j’avais eue un jour en passant mes doigts sur mes jambes et sur mon entrejambe comme si j’avais touché un corps étranger. Et il y avait ces heures que j’avais passées dans la salle de bains, une serviette nouée autour de la taille et me regardant dans la glace. Je m’imaginais sur la plage, en train de me changer, au milieu de la foule estivale, et j’allais passer mon maillot lorsque, perdant l’équilibre, je tombai sur le sol froid du carrelage, la serviette soudain dénouée et me retrouvant nu, sentant l’impérieuse présence de mon sexe que tous regardaient interdits mais qui me conférait à leurs yeux une importance que je n’aurais pas eue sans lui. Il me donnait d’exister.