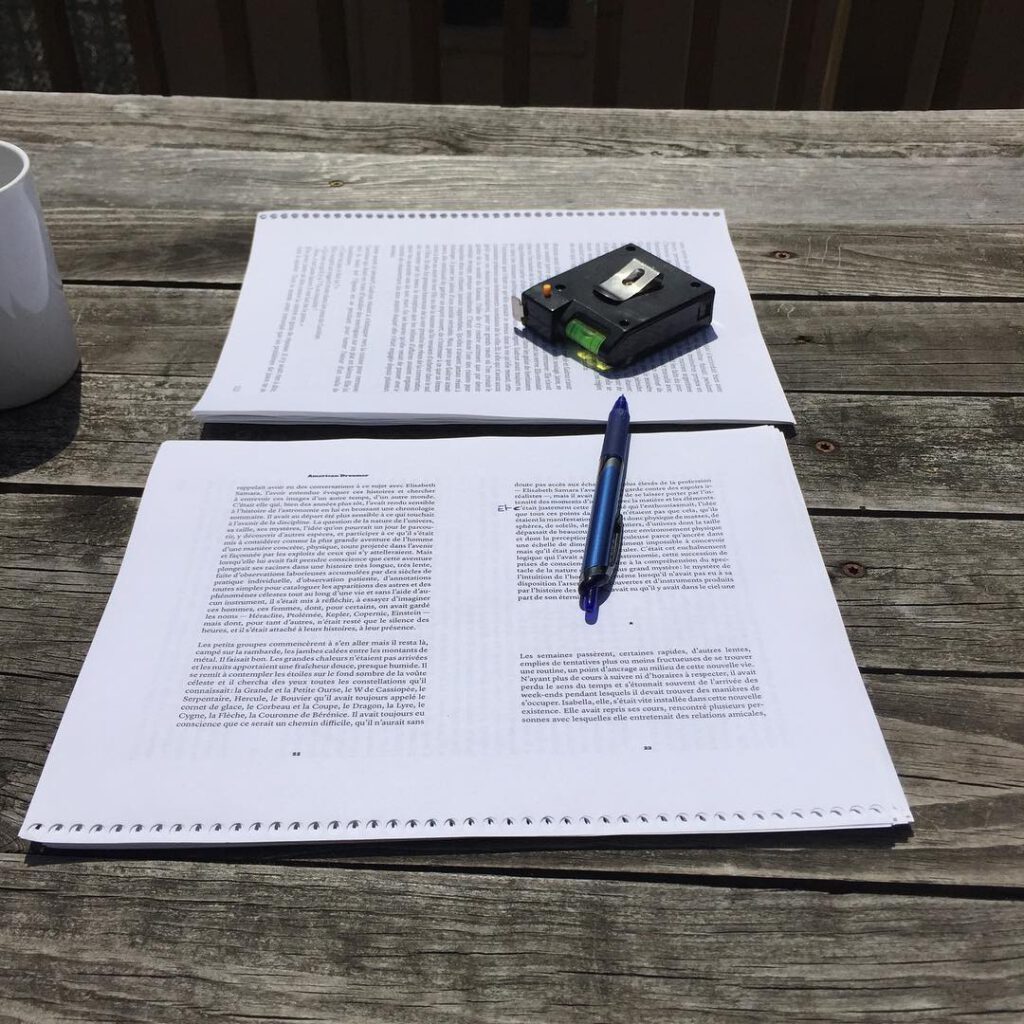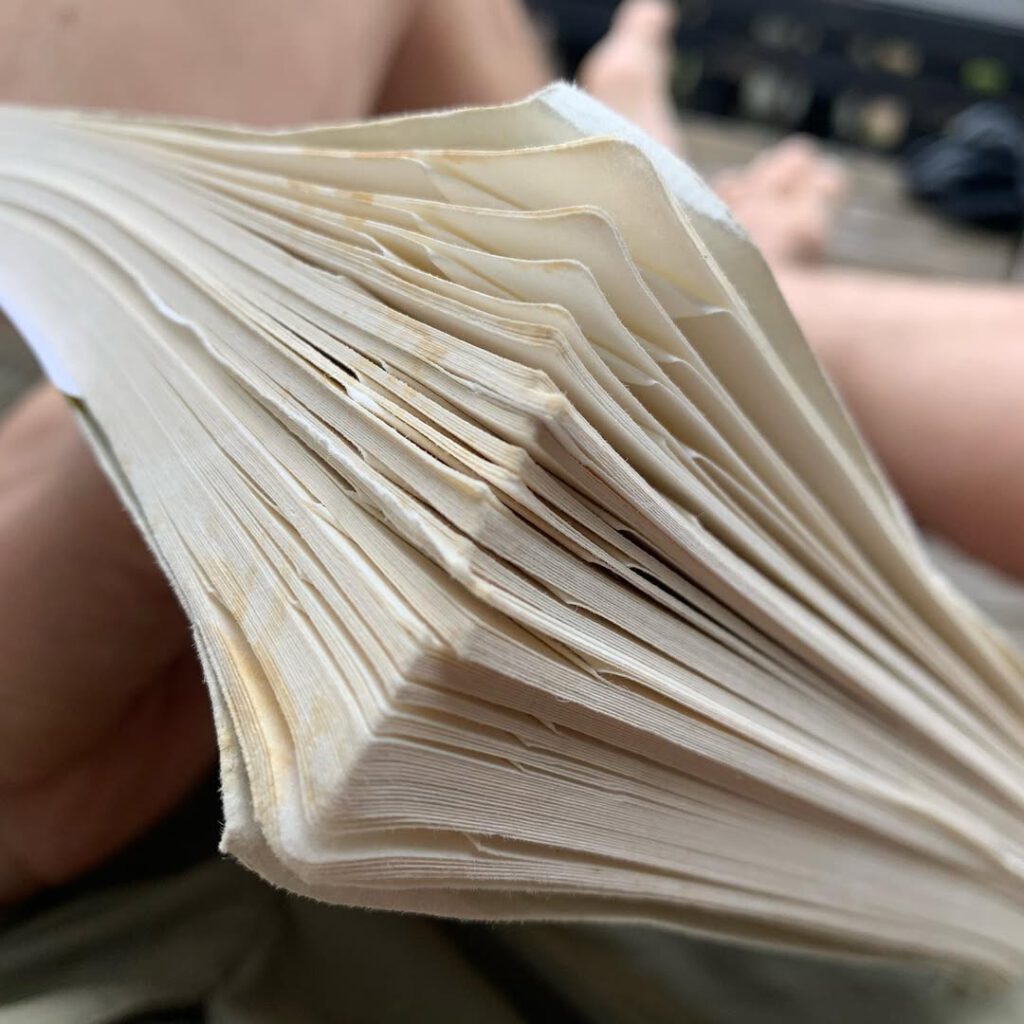(publié dans Connaissance des Arts, octobre 2018)
…
Il n’y avait pas un moment sans musique autour de Basquiat. Elle était toujours là, à l’accompagner dans sa création, porter ses idées, influencer son style. La galeriste Annina Nosei raconte que pendant les mois où Basquiat utilisa le sous-sol de son espace de Soho pour peindre ses premiers grands formats, ce dernier passait son temps à écouter le Boléro de Ravel en boucle, comme une obsession, comme il le fera tout au long de sa carrière avec de nombreux autres morceaux de musique, classique ou contemporaine. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la première personne à acheter une de ses toiles fut Debbie Harry, la chanteuse du groupe Blondie. Elle paya 200 dollars pour Cadillac Moon, une œuvre qui vaut aujourd’hui plusieurs millions et dont l’histoire témoigne de ce lien permanent entre l’œuvre de Basquiat et le contexte qui l’a vue naître.
Tous ceux qui ont connu Basquiat racontent que ses goûts musicaux étaient éclectiques, allant du disco de Donna Summer à la soul de Curtis Mayfield, de Bach au David Byrne des Talking Heads, de Beethoven à la musique créole qu’on appelle le zydeco. À sa mort en 1988, on retrouva dans son appartement plus de 3 000 albums de toutes sortes et de toutes époques, qu’il écoutait les uns à la suite des autres sur son électrophone. Alexis Adler, l’une des compagnes qui le verront passer en quelques mois des bancs de Manhattan à un loft luxueux prêté par Annina Nosei sur Crosby Street, mentionne que, dans l’appartement où il était venu s’installer avec elle pour quelques mois sur la 12e rue, Basquiat recouvrait de peintures et de signes tous les murs, tous les meubles et toutes les surfaces pour parer à la pauvreté et l’impossibilité de s’acheter des toiles mais que le seul objet qui resta immaculé était la chaîne hi-fi et les deux baffles dans un coin de la pièce principale.
La carrière de Basquiat s’enflamme au moment où la scène artistique new-yorkaise vit un moment comme il en arrive peu dans l’histoire. Profitant d’une quasi-faillite municipale qui a poussé les loyers au plus bas et qui a abandonné les rues à une débauche d’activités non contrôlées – la délinquance, le crime, la prostitution, l’usage des drogues, mais aussi l’explosion du graffiti, du hip hop et d’une culture urbaine survoltée –, les créateurs de toutes sortes se retrouvent plongés dans un univers bouillonnant d’énergie. Dans l’East Village et le Lower East Side, tous se retrouvent chaque soir et chaque nuit dans les vernissages, les défilés de mode, aux performances des uns et des autres et, bien sûr, dans les bars et les clubs – notamment le Mudd Club, le CBGB et Max’s Kansas City. Les influences et les talents se croisent, les idées s’échangent, les collaborations s’élaborent de la mode à la musique en passant par la peinture et la vidéo : Basquiat côtoie Grace Jones, Andy Warhol, David Bowie. Il sort même pendant quelques mois avec Madonna qu’il emmène vivre avec lui chez le galeriste Larry Gagosian à Los Angeles. L’époque est au DJing, au sampling, au scratching et ce sont les débuts de MTV qui révolutionne la scène musicale en faisant du clip l’un de ses médiums de prédilection. Basquiat baigne dans cette atmosphère, il en est un enfant prodige et en devient l’un des prophètes les plus influents. Il passe du graffiti à la création d’un groupe de rock industriel, Gray, dans lequel il joue de la clarinette et du synthétiseur, avant de se lancer, quelques années plus tard dans la production de Beat Bop, un single rap du duo de circonstance Rammellzee et K-Rob.
Mais, plus profondément, la musique est là, sur sa toile, comme un fil conducteur, une trame qui ne cesse de se déployer dans un univers pictural flamboyant et multidimensionnel, collant aussi au renouveau de la sémiotique dont on parle partout et qui privilégie l’analyse des multiples niveaux de lecture de la pensée et de la réalité. Elle s’insère par références glissées, par clins d’œil que les non-initiés ne reconnaîtront pas, mais également dans le rythme des toiles elles-mêmes, dans cette manière qu’a sa peinture de vibrer, de se déployer dans l’espace et dans le temps comme une partition qu’on est en train de lire ou une performance à laquelle on assiste. Médusé.
Le jazz a une place à part dans l’univers de Basquiat. Comme les figures des boxeurs qui représentent la résistance à la ségrégation et aux humiliations subies par les Noirs américains, les jazzmen constituent une image de la remise en cause de l’ordre établi. Basquiat aimait particulièrement le bebop dont l’influence s’impose à partir des années 1940 et qui encourage la créativité libre, la rupture mélodique, et il perçoit toute la force du jazz comme élément perturbateur et subversif. Charlie Parker, Dizzie Gillespie, Duke Ellington, Lester Young, Miles Davis font tous partie de ses héros. Il fait d’eux les sujets principaux de ses œuvres – Untitled (Sugar Ray Robinson), CPRKR, Horn Players – et il inclut leurs noms et des signes de leur présence au milieu d’autres toiles ou dans celles de sa série Discography où il liste ses morceaux préférés sur un fond noir. Il est également impossible de ne pas citer Now’s The Time, l’une de ses œuvres majeures qui reproduit sur un support de bois peint le vinyle de 1945 de Charlie Parker et qui condense, dans sa simplicité visuelle, toute la culture d’une époque et d’une personnalité, celle d’un Basquiat amoureux du son, du rôle politique de la musique, et de l’évolution des technologies qui permet de réinventer son usage et sa pratique.
L’univers culturel de Basquiat est trop vaste pour en rendre compte simplement. Les références ne se limitent pas à la musique. Elles sont artistiques, littéraires, historiques. De nombreux critiques et collectionneurs comme Jeffrey Deitch ou Adam Linneman parlent du dialogue constant que l’on trouve dans ses œuvres avec les plus grands noms de l’histoire de l’art, de De Kooning à Pollock, de Schwitters à Van Gogh, de la Vénus de Milo à Léonard de Vinci dont Basquiat connaissait l’œuvre en profondeur. La Joconde apparaît aux côtés de Nat King Cole dans Lye, les noms de Tibère et Plotin dans Famous. Certains diront même qu’il est le fils naturel de Dubuffet et de Cy Twombly parce que les lignes de ses figures rappellent les silhouettes du premier et que la profusion de mots, de ratures et de signes rappelle les grandes compositions du second. Pourtant, Basquiat n’avait pas reçu d’éducation artistique formelle outre ses nombreuses visites dans les musées avec sa mère Matilde. Mais son appétit intellectuel se nourrit de tout ce avec quoi il entre en contact, au hasard des émissions de télévision, des concerts, des lectures, des rencontres, des frustrations et des angoisses aussi, élaborant un univers où les idées, les noms, les références s’entrechoquent et s’enrichissent et préfigurant la culture contemporaine de l’hypertexte, d’un accès universel et chaotique à l’histoire et à la réalité contemporaine. Les œuvres de Basquiat sont en cela comme des palimpsestes, révélant peu à peu des niveaux de lecture différents, des sens cachés, des apparitions que l’on n’attendait pas, et les transcendant dans une apothéose de couleurs et d’énergie. « Boom for real » comme il aimait à le répéter.