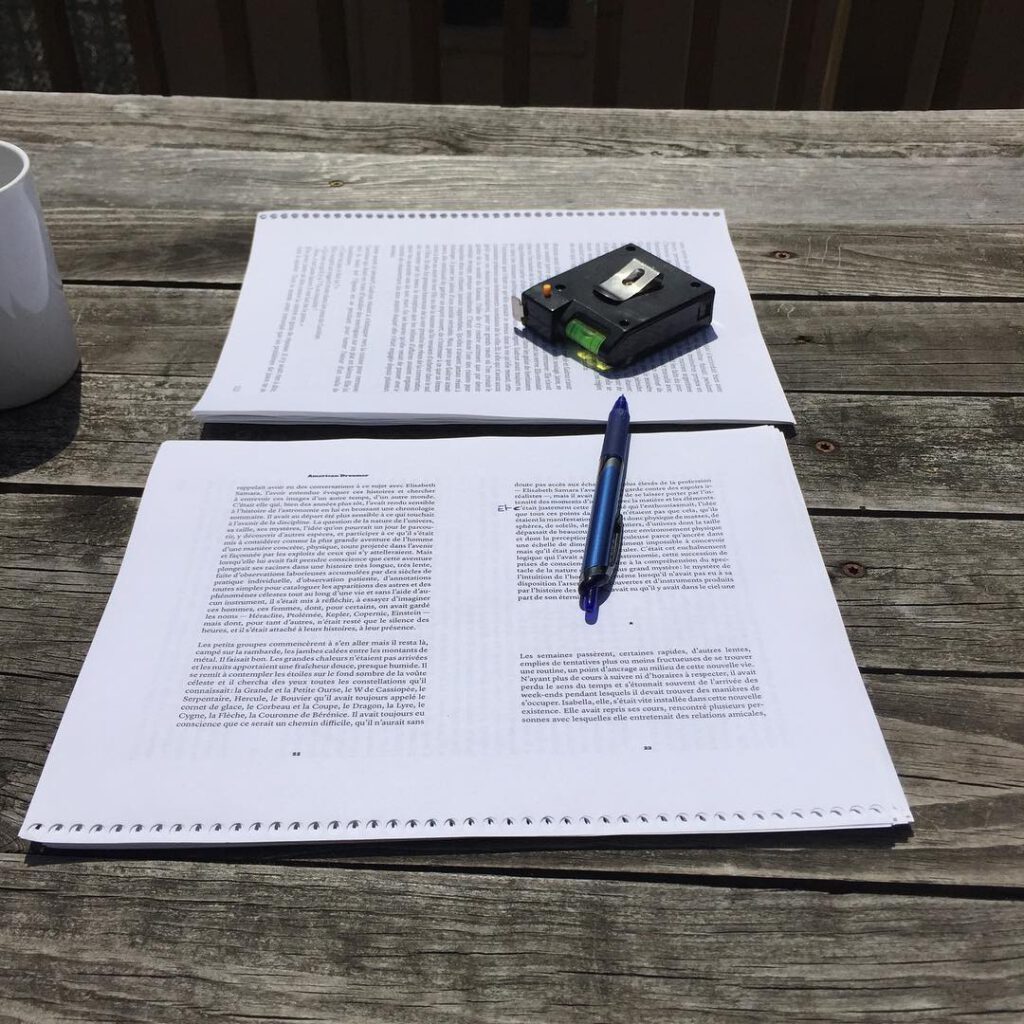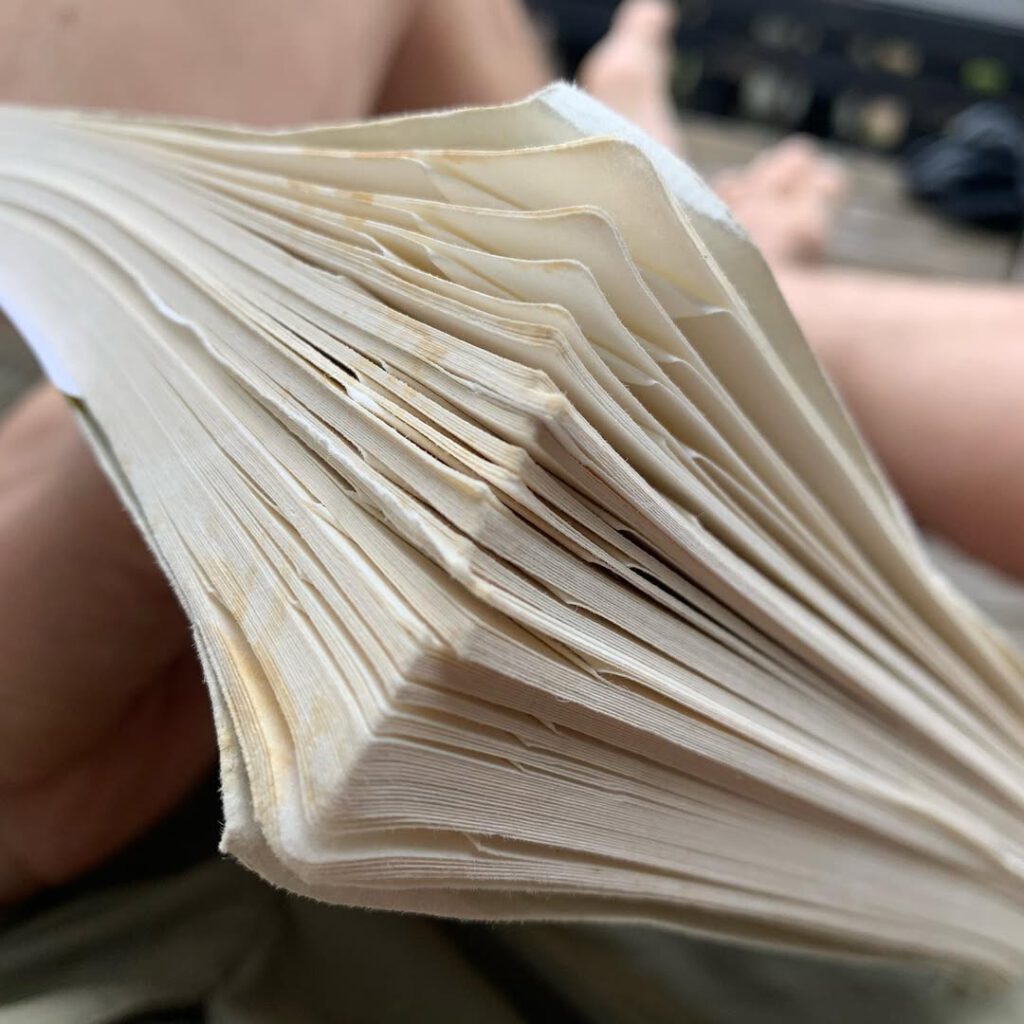…
des bribes à la surface, débris dans le flot, le projet dont je ne sais pas encore la forme mais
j’encercle l’ombre
chaque jour
des intuitions enfouies, les temps se chevauchent, une chronologie émerge, émarge
parfois
chaque jour aussi le désir, inéluctable, perturbateur,
le besoin de voir dans l’autre, n’importe quel autre la trace de l’attirance… un regard
dans le terminal
de bus, le parc, l’avion, dans le magasin, la rue, dans un sous-sol
tranquille, sur les applis, partout, nulle part,
un regard de biais, l’appui, je fuis le vide jusqu’au moment où s’apaisera enfin l’intensité du doute
fondamental
un métronome dont le balancement ne s’arrête jamais
tic-tac tic-tac tic-tac, mes doigts sur le piano attendent, gelés
le projet donc :
revisiter des temps en vrac,
laisser s’épandre l’histoire
de mon désir
(par action, par omission ?),
l’intermittence des feux de la consomption
méandres entremêlés
une intuition :
derrière l’inexorabilité du désir – j’emploie ce mot à dessein, aucune prière, aucune volonté ne peut le fléchir – et son omniprésence dans ma vie : des jours, un comportement qui se répète
sans cesse
depuis toujours,
depuis que j’ai 16 ans, 15 ans, 14 ans, 13 ans peut-être, différemment, avant (évidemment),
mon corps
revit
remet en scène chaque fois
le même enchainement, le même besoin : une tension,
– violente généralement – plus je la maitrise, plus elle devient violente –
vers l’autre
quel qu’il soit
QUEL
QU’IL
SOIT
pour combler le vide insupportable
d’où :
la multiplication des errances, physiques, mentales,
électroniques face à l’écran
démiurge,
le créateur de territoires in-
interrompus, inhabités de visages aussi, de corps, de formes qui muent trop vite, que j’accélère, je passe sur les préliminaires, les atermoiements, il n’y a qu’un but, atteint toujours trop tard, trop vite?
comment te nommer? j’ai trop appris à ne pas te dire, ne pas te penser,
dissimuler ton existence
jouissance qui ne dure pas, la
coruscation du météore
la nitescence
l’éclat intermittent
le miroitement de notre union
caduque
je tombe
je m’écoule en toi
ou tu t’écoules en moi
souvent, le défaut, la version courte, sale, inopportune et mal vécue,
dans les sex-clubs, dans un vestiaire, dans des toilettes
publiques, un attouchement dans le métro, ta bouche, la mienne, un remplacement qui ne suffit
jamais
mais rien ne suffit
jamais
tu restes hors de portée,
inatteignable,
imprescriptible
ce que je cherche: le point de départ de mes errances, de ce désir diffus, désordonné en permanence, et sa violence qui embrase tout, emporte tout, désaxe tout
sans cesse
une seule bouée (duale): mon écriture et
JONATHAN
et Saint-Laurent (son grill peut-être, être brûlé, martyr, sublimation)
une intuition en filigrane :
mon désir naissant
au monde se matérialise de manière concomitante avec
l’interdit fondamental et NIE
pour jamais
la possibilité de l’union
(à l’autre)
un jeu des consciences troubles et floues
(toute)
ma vie: la recherche d’un retour à cet avant, celui où l’autre
peut
-être aimé
cette idée trouvée hier dans l’Unlimited Intimacy de Tim Dean et sur laquelle j’élabore (plus avant):
le cul dans le monde gay: l’équivalent des entrailles – de la Vierge, l’endroit où tout commence et tout finit
jouir en toi: le don irrévocable,
l’union que tu ne peux nier, me garder en toi, garder ma semence: une nécessité absolue, spirituelle, tu
deviens
moi
1986
l’été
nous sommes en Corse (Tiuccia) et j’ai douze ans
DOUZE ans, un enfant donc
les étagères d’une supérette
un été lumineux comme tous les météores
sur l’étagère, mon regard, mes doigts s’arrêtent : un magazine,
une photo – en noir-et-blanc, pourquoi la vois-je en noir-et-blanc ? lorsque je cherche dans les archives du net, celles de l’époque sont en couleurs, un numéro
spécial alors ? qu’importe… un titre : GAI PIED, je sens mon coeur qui bat, la progression
fulgurante, astronomique? quel est le mot ?
(l’abscisse lâche l’ordonnée) :
exponentielle
une certitude instantanée, horizontale, indélébile dans le même temps,
je conçois, je re-
connais immédiatement ce que je vois:
le corps (d’un homme), sa nudité, le sexe en offertoire, huilé, luisant, l’exaltation/jubilation, une antre s’ouvre où je glisse
non, je ne m’y engouffre pas, j’y suis déjà (un incarné), contenu intégralement par un désir qui ne naît pas
là,
qui pré-existe et qui attend, dans l’ombre,
épiphanie d’un sens qui me dirige vers le convoité, l’aimé,
l’absent déjà, le volubile insaisissable
je nais
je naquis
je naitrai
j’étais né
que je fusse né
je nais naissant
je sens la honte pourtant, immédiatement, la peur…
je me cache aux yeux
(de mes parents, mes soeurs, mon frère, et les clients de la supérette sans doute,
mais non, l’oeil était là et dans la tombe et regardait
Caïn, une loge en moi, inexorable – je prie sa mort déjà, j’implore un dieu, les dieux, une croix au Golgotha s’enfonce, Piss Christ et Serrano, la confusion en
bouillonnement, le magazine, l’image et mon désir,
conscience de la souillure irrémédiable, un sexe en bouche qui contredit l’hostie
sacrée,
je ne pourrais plus…
je sais et j’entrevois
l’avenir, toutes les douleurs, l’inter-
diction en SURGISSEMENT, un lit dans Manhattan, une chambre grise et des posters, Iain
et j’ai DOUZE ans)
fugacité de l’instant, gardé comme aucun autre,
l’éveil, non, pas l’éveil, la marque du fer
rouge sur ma peau,
une fleur-de-lys, l’opprobre, toi Mylady à Meung, juste une épaule qu’on entrevoit entre les portes, je me sais gay sans le savoir, sans posséder le mot, l’idée, le référent, je suis sans pouvoir être
cet évènement en Corse, sa datation (dilatation)
exacte : août 1986 (ou août 1985, ce qui le rendrait encore plus
précoce dans l’archéologie re-
naissante),
l’enfant (le jeune adolescent? j’ai toujours douté avoir vécu l’adolescence,
pourtant je l’ai traversée, en souterrain, mes veines, un sang vicié,
tempétueux qui se masse/se masque sous une extase
mystique, mes poings serrés/contraints, anéantis, l’intensité de la prière
physique, mon corps en convulsions prématurées),
sa conscience évidente pourtant :
la solitude, mon
premier reflexe au monde : la dissimulation
une incertitude: d’où me vient la compréhension du mot GAI dans cet avant prématuré ?
le bus de Weehawken, matin de décembre 2023 :
sentir une jambe contre la
mienne, chaleur errante qui me ressemble/rassemble,
sent-il l’abysse qui se resserre ? l’espace contracte le vide
enfin
quelques secondes où j’imagine le don, me perdre en lui, cet inconnu
qui passe
un attouchement, le plaisir pris, subtilisé ? ou n’est-ce
que moi, l’esprit qui part en vrille dans le contact qui ne dure pas, que je ne provoque
pas, ou est-ce déjà une provocation de ne pas retirer ma jambe immédiatement, de tendre vers l’autre, chercher l’idée qu’il me désire, qu’il puisse
m’aimer
l’intimité, l’amour, la clandestinité unis, toujours concomitants, des compagnons (de mer,
houleuse et démontée) qui me servent autant qu’ils me trahissent parce qu’ils s’annulent mutuellement
je n’ai pas d’autre manière de penser l’élan, le mouvement de mon corps, de mon esprit vers cet ailleurs où je rencontre UN autre, son unicité baignée dans la multiplicité
du doute
du flirt
du besoin
recommencer chaque fois, chaque jour
Sisyphe remonte la pente, conquiert les cimes, des sommets
solitaires, exaltés, une passion sourde, réinventée, re-programmée, un cycle sans fin, sentir la flamme qui se rallume, son origine
immémoriale, je reviens aux premiers temps
de l’univers, de l’espèce, mon espèce
dégingandée, je recompose l’instant où nait la propulsion de l’atome vers l’infini, une étincelle itérative qui cherche sa proie, sa dualité
rencontrer l’autre donc
renouveler chaque jour l’essai, la tentative désespérée,
quérir
[je quiers,
je querrai,
que je quière,
quiero pour je t’aime (en espagnol, Pierrot)]
non pas des inconnus en catalogue mais des amants possibles, L’amant, l’Amant, l’aImant qui me repousse autant qu’il me conserve dans son orbite,
un dieu jaloux, un dieu tonitruant mais il refuse ma vue,
mes sens, l’idée de mon désir
impénitent (« avant même que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais… » pourquoi alors
m’avoir laissé le libre-
arbitre, le choix de la chair, la vie qui tend
vers l’autre insaisissable? pourquoi ce vice immonde/sublime, celui qui fait de moi
un homme, le fils
de l’homme et son amant recomposés, réinventés, un linge/linceul pour la résurrection, dernier hommage au corps qui tend vers
l’autre
inaccessible)
la théorie de la masse fait de la matière un élément indestructible,
en moi, cette étincelle qui ne crée jamais de feu, jamais de feu durable (sauf Jonathan, évidemment, une exception au théorème mais il n’embarrasse pas le mouvement qui se reproduit
en permanence)
l’élan originel réduit au point de départ, contré immédiatement,
soumis,
gâché,
un pied bandé qui se déforme,
le jet qu’on contrecarre mais qui n’admet
pas sa défaite, sa négation
nécessité du feu qui naît
plus loin encore
la plage encore, Les Lecques cette fois, près de Marseille, les jours sublimes, lumière d’été qui ne tarit pas, le vent, le bruit du vent, des mats qui claquent, l’odeur du sable
chaud, humide les pan-bagnats et les beignets, des corps, des cris, simplicité des heures, de la répétition, nos rituels : je m’accroche à cette idée
du rituel, le rythme atone, immuable pendant des semaines, l’ancrage d’une certitude, la vie
impérative, TOUT
à/a sa place, mon père, ma mère, mes frère et soeurs (soeurs et frère?), dans le miroir tout se ressemble,
s’assemble,
l’année, qui sait? 1982-83-84 peut-être
mon père est là donc c’est l’avant
sa mort
l’avant 87-86-85 (les années corses)
je remonte encore, tu me suis ?
enfant : ce mot que j’utilise pour dire l’in-décidé, l’informe en moi, ce qui est malléable, ce qui découvre le monde,
s’imprègne
je sens le roc pourtant, le granit dur, ce qui était
je regarde les hommes, les bosses sous les maillots, les sexes (je n’ai pas le mot, encore mais j’ai le fantasme, l’envie de toucher, non pas de la main mais du regard, une possession violente, totalitaire (fragile aussi parce qu’elle s’ignore
encore)
tu ne m’échappes pas
je te vole l’intimité, toi, oui toi qui passe, toi l’inconnu que je viole
au-dessus de ma serviette bleue/violette)
je me/nous (mon frère et moi)
revois sur le
mur de béton qui borde la plage, l’endigue, ceint nos vacances, un horizon-miroir qui nous renvoie vers la haute mer, la baie, le Bec-de-l’aigle et ses rochers qui fusent, les grands portiques pour les bateaux en construction, la pointe des pins sur le sentier du littoral, mon père et nos canots, les palmes, les rames, les caoutchoucs que l’on détache puis qu’on rattache aux dames de nage, chaleur qui réverbère sur le latex, le néoprène, ses deux couleurs en duel : le jaune, le bleu…
le bleu intense des flots
pourquoi ce retour sans cesse à la Madrague, la baie des Lecques, un bord de plage, la mer, le sable, les heures s’écoulent
paisiblement
un monde en liens, figé, les mêmes albums, les mêmes bandes dessinées que je retrouve chaque fois au même moment, le mois d’août, que je relis, capture du temps qui se recycle, se ré-impose au-dessus de la grille
des ans,
un inchangé
limpide, inépuisable, continuité qui me protège de la rupture que je pressens (mon inconscience à ce moment : un subterfuge que je ne sais toujours pas contrer, percer,
les souvenirs restent rebelles à toute idée d’écorchement, de craquèlement, pourtant mon corps grandit, s’étend, je reste l’enfant
seul
sur la plage
déserte
des tracteurs passent, ratissent le sable, de grands sillons en ligne,
tout
matérialise le plat, la plaine sans faille?
un encéphalogramme qui dit ma mort
clinique, l’absence de réaction à l’aube (obscure) de la sensualité
sinon celle de retour sans fin au même,
l’impermanence se fait menace
je vois le monstre poindre
je dis :
« ils ont des bosses toutes rondes, énormes sous leurs maillots », je ris, et, dans ce rire (de connivence, de connexion), se loge l’élan défiant le statu-quo, la paralysie
du corps, ma vie à venir (insoupçonnée), une candeur (que je ne retrouverai pas, jamais)
mon frère s’esclaffe aussi, je me rappelle ce rire (pudique, gêné? ou bien est-ce moi?), j’entends le vent qui souffle et qui l’emporte
l’écho se dilate, les cris s’estompent, des nuages sombres s’avancent et s’amoncellent, écrasent mon insouciance
je deviens l’obscur, celui qui cache sans le savoir
comment revenir au jaillissement sublime, incontrôlé qui annihile la peur, qui la ravale ?
nos peaux, ces membranes a-
ssoiffées
de l’autre toujours évanescent
les baies de la Seine, l’hiver, les feux mouillés (jaunes/rouges) des véhicules en réflection sur la chaussée
humide,
pluvieuse,
novembre/décembre/janvier, un froid qui mord, la nuit qui glisse, s’étend, se fait envahissante,
et les grandes grilles du parc de l’autre-côté de la voie rapide, mes pas précipités, j’arrive de la Concorde, l’une des stations qui me ramènent dans un détour improvisé, je n’ai pas suffisamment
de temps, jamais, chaque fois je vole des heures, je les bouscule, je leur impose un rythme
saccadé, j’emplis le trop-plein déjà, je bourre jusqu’à l’ourlet le tissu qui craque
mon inquiétude : multiple
chercher un corps, un autre
chercher l’anonymat, la solitude
chercher l’inaccessible
anesthésier le besoin qui point, qui sourd, qui ne me lâche plus, jamais, sa récurrence s’impose au quotidien, même la prière ne suffit plus, les jeûnes d’avant la Pâque, les exercices
spirituels, mon attirail inefficace
je parle à des zombies, des ombres comme moi, des corps qui vaquent dans un brouillard, une zone délimitée, un périmètre de l’entre-deux, l’entre-trois, l’entre-quatre: la Seine, les quais, les voies rapides, les grilles
des escaliers descendent vers un non-lieu, un souterrain qui mène au parc, fermé le soir, la nuit,
l’odeur de pisse évidemment, l’annonciatrice
de liberté
j’ai dix-sept, dix-huit ans, vingt ans
ceux que je croise ont tous dix ans de plus, au moins,
déviant, une courbe tend vers l’infini
je ne sais toujours pas ce que je cherche exactement, si j’avance trop vite, trop lentement, si le cheminement chaotique de la pensée, des souvenirs, peut convenir à un récit, ce récit, mon récit,
la narration : une obsession évidente, celle des mots qui se risquent de se suffire à eux-même, du serpent qui s’entortille, Laocoon abandonné sur une plage chaude, offert aux rayons qui le brûlent, la sensualité d’un jour d’été
Joan Didion parle d’atomisation, l’acceptation
de l’atomisation avant toute chose
dé-construction, ses émotions teintées d’un tout qui ne laisse de place à rien, l’imaginaire gangrené, un territoire occupé
me prouver que la récurrence fondamentale, envahissante du désir dans ma vie, ses manifestations protéiformes (physique, affective intellectuelle, l’impossibilité de l’ancrage, la nécessité de l’errance, tous les désirs nourrissent ma soif qui ne s’étanche jamais), résultent de l’avortement prématuré du désir originel, du désir naissant, que cette concomitance (désir et interdit
ontologique,
existentiel)
entrave à tout jamais la possibilité de l’amour durable en moi, sa valeur
réconfortante ?
l’ancrage
un mot
essentiel
ancrage de l’infini
tangage de l’immobile, mes mots
quoi d’autre alors dans ce foutoir ? ai-je besoin de penser le texte, l’organiser ? qu’est-ce-que le récit sinon la forme que je donne, mouvement vers l’autre donc…